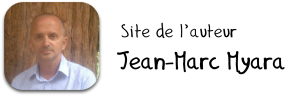Histoires extraordinaires de gens ordinaires
Papy et Mamy

C’est en écoutant la radio que j’appris la mort de Papy. Sur Radio Classique je crois. Chef d’orchestre à Radio France, il avait mené à la baguette les plus grands répertoires de la musique classique et sa notoriété avait dépassé le cadre de l’établissement connu pour son architecture ronde et ennuyeuse. Nous ne nous voyions plus beaucoup. Le pire c’est que je ne me rappelle plus véritablement la raison de notre fâcherie. Je voyais en lui le prototype de l’ermite, obnubilé uniquement par son art, et lui se désolait du jeune écervelé que j’étais en train de devenir. Encore une fois un absurde conflit de génération, une incompréhension entre l’expérience et l’immaturité, mettait à mal des années d’amour et de filiation.
L’inconvénient avec l’imbécile, c’est sa certitude d’avoir toujours raison et son inaptitude à entendre la voix d’une génération passée et donc forcément obsolète. Je suis un con qui n’aura de cesse de déplorer que l’intelligence ne soit pas transmissible. Depuis que Papy n’est plus là, il n’y a plus personne pour comprendre la sincérité de mes larmes et le supplice de mes soupirs.
Papy n’avait jamais été démonstratif dans son affection, ni généreux par sa présence. Il était pourtant là, présent au moindre coup de semonce, prêt pour accomplir son devoir. Pour le reste, il considérait que, hors de toute sollicitation, sa permanence n’étant pas indispensable, il pouvait vaquer à ses occupations quotidiennes. La musique et uniquement cela.
Mamy prenait des nouvelles fréquemment, à son rythme, une fois par semaine, quand Papy faisait la sieste en général le samedi après-midi, une fois les répétitions achevées et avant la retransmission en direct à la radio le soir même, d’une symphonie où d’un concerto. Ce repos était sacré, aussi Mamy, pour faire le moins de bruit possible, s’isolait dans son petit bureau situé à l’autre bout de leur immense appartement du douzième arrondissement de Paris, séparé de la chambre à coucher par cet interminable couloir délimitant l’espace réservé à leur vie personnelle avec celui où l’on écrit et parfois l’on compose.
Mamy mit cinq enfants au monde, ma mère, deux tantes et deux oncles. Chacun d’eux n’aura qu’un enfant, comme s’il fallait perpétuer une lignée sans trop en faire. Comment a-t-elle bien pu s’y prendre ? Mamy c’est une petite crevette, si chétive que le vent doit l’éviter par prudence, afin qu’elle ne s’envole pas les jours de brise. Elle s’appelle Renée. Elle est morte deux ans après Papy. Un jour, petit enfant voulant se prendre au sérieux, je lui fis part de ma déception d’avoir une grand-mère se prénommant Renée. Seuls les vieux et les vieilles s’appelaient de la sorte. Elle me prit sur ses genoux, puis suggérant que du haut de mes cinq ans j’étais un grand gaillard finaud et habile d’esprit, j’étais en mesure de comprendre le secret de sa naissance. C’était entre nous, de prénom de vieille à petit garçon pas très adroit dans ses commentaires. J’appris que pendant une semaine personne n’avait songé à lui donner une identité, ne sachant pas si elle allait rester pour un petit bout de temps ou quitter sa famille à peine les présentations effectuées. Mamy souffrait d’une malformation respiratoire, une maladie infantile entre tuberculose et pneumonie, l’interprétation que je donne est celle de mon souvenir. Elle ne devait pas passer la nuit et pourtant, au petit matin, ce microscopique être, se cramponnait à un léger souffle de vie pour garder espoir. Elle hoquetait l’existence pour durer par intermittence. Elle décida, que malingre et délicate, elle serait plus forte que l’injustice et dégagerait une force insoupçonnée. Elle se tira elle-même d’affaire, c’est comme cela que les médecins interprétèrent cette farouche obstination de ne pas lâcher prise et elle naquit de nouveau. Elle était re-née. Voilà l’origine de son prénom, et voilà pourquoi, pour rien au monde, elle ne s’en séparerait.
Renée a tenu bien au chaud dans son ventre cinq enfants, à tour de rôle bien sûr. Mes oncles et tantes ne sont pas des colosses, mais ils possèdent une charpente solide et une taille haute. Comment d’un si petit creuset purent sortir des enfants si peu similaires au modèle originel ? La nature est mystérieuse.
Jusqu’à mes dix ans, nous habitions à deux rues de chez mes grands-parents. Papy, une fois dans son auditorium de Radio France, laissait Mamy à son ouvrage. Elle travaillait pour une maison d’édition littéraire où elle mettait en forme la prose d’écrivains inventifs, mais pauvres en grammaire. Elle rendait morphologiquement acceptable des chapitres entiers avec les conjugaisons et les compléments d’objets directs. Certains écrivains de renom, par contrat auprès de maisons d’édition, exigeaient d’avoir Mamy pour correctrice. Ils louaient son savoir-faire, son souci de ne jamais porter un jugement et surtout, sa discrétion.
Maman me déposait chez Mamy quelques heures dans la semaine, en général pour le goûter. Mamy me servait une limonade, quelques gâteaux fondants dont la saveur me poursuit encore aujourd’hui, et m’installait devant le piano pour juger de mes aptitudes envers cet instrument. Quelle patience ! Combien d’heures ai-je pu passer à taper sur des touches noires et blanches, sans aucune notion de rythme, sans la moindre oreille musicale, aux côtés de Mamy imperturbable et attentionnée ! Que cette femme devait m’aimer pour accepter que je rende si peu hommage à la musique et à ce piano sur lequel de prestigieux solistes avaient de façon si magistrale interprétés les plus grandes œuvres.
Mamy est morte par négligence. Elle qui était re-née pour une vie, avait oublié que la maladie est rancunière. Elle devait à ses bronches d’avoir failli manquer exister, aussi une pneumonie l’emporta. Elle mourut par où elle n’aurait pas dû survivre. La mort venait de se rembourser.
Elle resta longtemps à l’hôpital et ne voulut voir personne. A peine ses filles. Pas ses fils. Je ne sais pas pourquoi. Surtout pas ses petits-enfants et ce que je sais, je le tiens de ma mère. Elle voulait que l’on garde en mémoire l’image respectueuse d’une grand-mère debout, immense du haut de son mètre cinquante-deux et forte de ses quarante kilos. Je pleure encore ce petit bout de Mamy, perdue dans un lit trop grand, des tuyaux en guise d’oxygène et pesant à peine le poids de quelques brindilles. Si peu pour se construire un nid douillet.
Papy était beaucoup plus vieux que Mamy et pourtant elle ne lui survécut que deux ans. Je pense qu’elle est morte d’ennui. Mon grand-père avait la stature du commandeur, aussi imposant qu’elle était gracile, il était à la fois mari, père, confident et sixième enfant. La vie de Mamy c’était Papy, il n’y a rien d’autre à comprendre, même à vingt ans d’écart.
Vraiment quel abruti j’ai pu être. Mes grands-parents étaient des puits de savoir et de bon sens. Ils avaient traversé les épreuves des gens de leur âge et appris à quels points les conditions de vie peuvent être difficiles. Je crois que mon grand-père s’était comporté honorablement pendant la dernière guerre mondiale. Il n’en parlait jamais, pourtant Mamy avait retrouvé des articles de journaux louant la bravoure d’un jeune homme à peine sorti de l’adolescence qui, dans sa région natale de Normandie, avait participé à faire sauter des ponts ou caché des aviateurs anglais dans la ferme familiale. Il gagna une médaille par-ci et un autre satisfécit par-là, mais il n’était pas de ceux qui se glorifient d’actes légitimes en des périodes troublées.
Il avait le don de la synthèse, sachant rendre limpides les situations les plus embrouillées et nous énervait de percer à jour, avec une telle acuité, les errements de chacun.
Papy, avec ses yeux d’un bleu transperçant, scrutait les gens au plus profond d’eux-mêmes avec ce regard signifiant qu’il ne fallait pas la lui faire. Il impressionnait. J’aurai préféré avec le recul avoir un grand-père qui me fasse sauter sur ses genoux, au lieu de cela tout juste me rappelais-je les marques d’affection qu’il prodiguait à mon endroit.
Avec mes cousins et cousines nous avions un avis identique sur nos grands-parents. Seule Fleur, la plus jeune, ne se prononçait pas. Elle était partie très tôt en pension et nous avait assez peu fréquentés. Pour les quatre autres, nous avions un Papy taiseux et si peu démonstratif dans son attachement, que nous ne comptions pas les jours séparant notre prochaine visite. Nous les aimions, mais sans plus, parce qu’il faut aimer les parents de nos parents. Nous sommes passés à côtés d’eux, presque sans nous en apercevoir.
Mamy comblait les manques. Une conversation téléphonique durait des moments interminables pendant lesquels de sa voix fluette elle prenait connaissances des évènements jalonnant notre vie. Ensuite elle faisait le compte rendu à un Papy infoutu de prendre des nouvelles par lui-même.
Les seuls moments où notre famille se réunissait au grand complet furent plutôt rares. Papy avait hérité de la ferme normande de ses parents et il avait entrepris de la restaurer une pierre après l’autre. Après quinze ans de travaux où les économies de mes grands-parents se diluaient dans les charpentes et les solives, cette maison fut enfin digne d’accueillir leur descendance.
La maison se situait vers Pont-l’Evêque, loin dans les terres, à trois heures de voiture de Paris. Nous y passions les fêtes depuis Noël jusqu’au jour de l’an. Quand nous avons eu seize ans, nous les jeunes préférions célébrer la nouvelle année avec nos amis et désertions de plus en plus souvent les rendez-vous normands. Nous ne semblions pas manquer au décor qui nous le renvoyait bien.
Cette maison constitue encore aujourd’hui une partie importante de mes souvenirs d’enfance. C’est moi qui l’ai gardée. Elle devait revenir de plein droit en héritage à mes cousins et à moi-même, nos parents s’en désintéressant dès la maladie de Papy. Ils n’avaient aucune intention d’entretenir une bâtisse gigantesque et couteuse à maintenir en l’état. Eux-mêmes ne semblaient pas montrer d’attachement particulier à l’endroit et plutôt que d’hériter du cinquième d’une maison ne valant pas grand-chose, ils l’avaient laissée dépérir « dans son jus », suggérant que les enfants pourraient l’utiliser à leur guise et continuer d’en faire un lieu d’unité familiale si bon leur semblait. Un port d’attache. Aujourd’hui j’y reçois qui veut bien venir.
Mon grand-père mit du temps à mourir. Il resta allongé plus de cinq ans, se levant par nécessité, avec effort et douleur. Il souffrait de partout, son corps ne lui laissant aucun répit. Je crois que le pauvre homme a accumulé toutes les vicissitudes que propose la maladie à un corps réceptif et la liste de ses maux serait trop fastidieuse à énumérer. Heureusement pour lui, il avait gardé toute sa tête et au quotidien, il exprimait à ma grand-mère la félicité d’avoir traversé l’existence à ses côtés.
Mes grands-parents avaient le sou sans en avoir l’air. C’est ce que Mamy révéla à son entourage avant de mourir à son tour.
Comme la pauvre chérie n’avait plus toute sa tête, ses enfants ne prirent pas ses révélations tardives au pied de la lettre, surtout les aventures rocambolesques d’un Papy polygame et découvreur de trésors. Elle délirait.
Je raconte.
Papy était un homme connu et estimé par ses semblables, je veux parler ici des manieurs de baguettes du monde entier. Il avait dirigé des orchestres dans différents continents et sa notoriété, si elle n’était pas celle d’un Karajan, était suffisante pour qu’il se produise dans les salles de spectacles qui comptent des quatre coins de la planète. Il appréciait beaucoup un maestro japonais dont le nom a peu d’importance et il se rendait fréquemment dans ce pays qu’il affectionnait particulièrement. Il y fit des aller-retour durant plus de quinze ans, sous divers prétextes et souvent sans engagement. Mamy ne l’accompagnait jamais aussi loin et ne doutait pas que mon grand-père eut besoin d’être paisible pour mener à bien différentes négociations et planifier une tournée de concerts dans un pays si mélomane. Le Japon de cette époque était une sorte d’Eldorado en devenir. Ce pays partagé entre d’ancestrales traditions et une énergie naissante regorgeait de vitalité et l’argent s’investissait dans l’innovation et la préservation du patrimoine culturel.
Mon grand-père était une poupée gigogne. A l’intérieur, sur plusieurs niveaux, une surprise pouvait en cacher une autre. Je ne saisis pas encore aujourd’hui jusqu’à quel point Mamy était dupe et jusqu’à quel autre point elle était soumise. Je pense qu’un jour je ferai ma petite enquête et me rendrai à Osaka faire connaissance avec une autre grand-mère aux yeux bridés, avant qu’il ne soit trop tard.
Mamy n’avait pas fait de testament écrit. Quand je parle de testament, je n’évoque pas juste la liste des biens qu’on lègue à une descendance, effectuant le partage pour distribuer à chacun une quote-part selon les mérites qui lui sont attribués. Non, je parle du testament d’une vie, où l’on se raconte sans le narcissisme de celui qui pense que ses actions méritent d’être notifiées, mais plutôt comme on justifie envers les êtres aimés les efforts entrepris pour braver les bouleversements de l’existence. Le souvenir est à ce prix.
Papy lui aurait un jour craché le morceau. Il était tombé sous le charme du premier violon de l’orchestre d’Osaka, un petit oiseau flamboyant, dont les doigts sur l’archer arrachaient à son instrument les sonorités les plus troublantes et mélancoliques. Le profane ne peut comprendre l’émotion procurée par la perfection, et là où une oreille dilettante se contente d’apprécier sans saisir, l’amoureux rencontre l’extase. Il fit un enfant à une belle orchidée qu’il ne put élever au sens commun du terme, mais avec lequel il communia plus de quinze ans durant. Il avait composé deux familles aussi éloignées que l’océan est incommensurable. Comment était-il avec eux ? Tendre ? Affectueux ? Passionné ? Pourquoi aurait-il été le feu là-bas et la glace ici ? Aimaient-ils ces gens-là plus que nous ?
Un jour, il ne voyagea plus et tout se tient finalement dans sa chronologie. Pendant un an, il resta prostré dans une déprime si profonde qu’il avait, selon l’expression de maman, traversé le miroir. Personne n’avait, à cette époque, interprété la raison d’un abattement si intense et c’est Mamy sur son lit de douleur qui avait fourni une explication.
Un tremblement de terre, comme ce pays en connait si souvent, avait dévasté une petite île au sud du Japon, connue pour être un lieu de villégiature de collégiens et une classe entière fut décimée dans un fracas assourdissants de murs qui s’effondrent et de tôle qui se broie. L’enfant de Papy fut enseveli sous les décombres.
Sa famille du bout du monde venait de subir un drame épouvantable quand lui, à plusieurs milliers de kilomètres de distance n’était qu’impuissance et désolation. C’était un fils, un oncle, qui périt de l’indélicatesse d’une terre qui tremble et engloutit en son sein autant d’innocents qu’elle peut en contenir. Pour ajouter au drame, un incendie dévasta la salle où les collégiens étaient en train de se réunir et les malheureux enfants devinrent cendres. Aucun ne put avoir une sépulture digne de ce nom où l’on se rend pour pleurer et se souvenir.
Papy retourna une dernière fois au Japon, pour dire adieu, quand son esprit tourmenté lui offrit cette liberté. Nous n’avons aucun détail particulier sur les quinze années d’escapades nippones de mon grand-père, mais nous pensons que pendant cette période exotique, il bâtit une grande partie de sa fortune entre Tokyo et Osaka.
Mamy, dans son délire, parlait d’argent, de lingots d’or en quantité industrielle planqués au fond du jardin, à l’abri des envieux et des banques. Des sommes tellement importantes qu’elles pouvaient donner le tournis à qui prêterait attention à ce genre de sornettes. Mes grands-parents étaient riches à millions, l’information avait de quoi surprendre. Ils n’étaient pas à plaindre, le métier de chef d’orchestre nourrit son monde, mais ne remplit pas la panse au-delà du raisonnable. Quant à Mamy, ses corrections littéraires ajoutaient simplement le beurre à l’épinard, dont elle semblait se contenter.
Alors comment un homme aussi convenu que mon grand-père put-il amasser une fortune considérable, la convertir en lingots d’or et l’enfouir dans son jardin, cela n’avait aucun fondement. La morphine qui calme la douleur et transporte le malade par-delà son imaginaire était responsable de l’état de Mamy qui faisait de son mari volage un aventurier au long cours.
Je tente ici une narration. Je n’ai pas vérifié de chiffres et ne possède aucune idée précise des montants en jeu. J’interprète les propos extravagants de Mamy, rapportés en bribes inintelligibles à ma mère en larmes, dans une chambre aux murs blancs et froids. J’en ai le droit, moi aussi, sans que la morphine coule dans mes veines et il me plait à imaginer un grand-père trafiquant d’art, faisant le coup de poing avec des hommes d’affaires véreux dans les bars mal famés de la banlieue de Tokyo. Ou d’ailleurs.
Papy avait donc pour ami un alter-ego japonais, chef d’orchestre issu d’une famille de notables dont le père aurait été un familier de l’empereur Hirohito. Cet homme, à la tête d’un héritage colossal, dépensait des fortunes pour acquérir les partitions originales des œuvres les plus connues du patrimoine mondial de la musique classique. Je ne sais ce que peut valoir un gribouillis complet et raturé de la cinquième symphonie de Beethoven, mais certainement beaucoup d’argent. Avec mon grand-père ils avaient formé une sorte d’association. Part à deux. Ils se mettaient en quête de documents originaux, les achetaient au plus bas pour les revendre au plus haut à des collectionneurs richissimes et discrets.
Papy n’était pas Mick Jaeger, mais il comptait une foule d’admirateurs heureux de lui arracher un mot, un sourire après un concert. Certains avaient des anecdotes musicales à raconter, des documents à montrer, des partitions à proposer. Papy écoutait et ne fermait jamais la porte à la discussion. Il possédait le charisme de ceux à qui il est impossible de dire non.
Il se faisait offrir tous types de documents ou les achetaient un prix ridiculement inférieur à leur valeur. Son ami faisait de même. Lors de dîners mondains, de réceptions un peu business et caritatives, il laissait entrevoir à quelques gros portefeuilles sans scrupules que peut-être, avec un peu de chance et de savoir-faire, il pourrait voir passer entre ses mains expertes une partition introuvable d’un grand compositeur. Bien sûr, après la discrétion de mise dans ce genre de concertation et n’ayant aucune idée précise du montant d’un tel trésor, il faudrait faire une offre qu’il soumettrait au dépositaire du document en question. Son authenticité ne posant pas la moindre interrogation.
Les premiers clients se trouvaient au Japon, pays où l’art n’est pas une simple denrée marchande. Le respect dû aux ouvrages des aînés n’est pas un vague concept. En possédant l’œuvre d’un génie c’est un peu de son âme que l’on capte et si l’argent ne rend pas plus talentueux, il permet d’acquérir ce que l’homme a pu concevoir de plus magistral au cours de son existence. Le japonais possède pour rendre hommage et faire une bonne affaire. La combinaison n’est pas une absurdité.
De fil en aiguille, un cercle restreint d’investisseurs avisés s’était créé et les commandes affluaient. L’offre devenant rapidement inférieure à la commande, les prix s’envolaient. Au début les paiements s’effectuaient en yen, en dollars, en roubles, mais le problème des monnaies instables est leur volatilité aussi, les deux chefs d’orchestres « contrebandiers » décidèrent de se faire payer en lingots d’or.
Un richissime homme d’affaire japonais qui tapotait à ses heures perdues sur le clavier d’un piano acheta contre or comptant une partition rare d’un concerto célèbre. Il organisa une réception privée où quelques-uns de ses amis, pianistes du dimanche et triés sur le volet, avaient pu interpréter l’œuvre en suivant de leurs yeux ébahis le document original écrit des propres mains de l’artiste. Comme si, par-delà les siècles, un compositeur génial allait pouvoir injecter une partie de son talent dans les veines d’un admirateur dépourvu de la moindre aptitude. L’adoration confine à la dévotion et se révèle lucrative pour qui sait en profiter.
Papy vécut chichement de ce trafic. Il amassa une fortune, mais n’en profita pas. Sa maison normande, certes confortable n’avait rien d’ostentatoire et il devint propriétaire de son appartement parisien après avoir acquitté, rubis sur l’ongle, chacune des traites bancaires d’un crédit long comme le tiers d’une vie. Il thésaurisait. Les lingots étaient planqués dans le jardin en attente de jours de disette et seules les fourmis et les taupes avaient loisir de côtoyer cette souterraine richesse.
Mamy avait donné deux versions expliquant l’arrêt du troc : or contre partition. La première étant l’absolue incapacité de Papy à remettre les pieds au Japon après le drame épouvantable survenu à son fils et une seconde plus crapuleuse. Son ami chef d’orchestre avait été retrouvé dans son appartement de Tokyo, baignant dans une mare de sang, assassiné par des hommes déterminés, son corps dénudé recouvert de partitions. Il y avait eu enquête et les transactions furent étalées au grand jour. La police fit son travail d’investigation et put établir qu’au moins la moitié des originaux aux mains d’acheteurs contrits n’étaient que des faux et parfois grossièrement contrefaits. La confiance absolue envers le vendeur, qui était la condition essentielle de ce genre d’acquisition par des acheteurs souffrant de myopie, avait été bafouée. Papy eut-il peur pour lui-même qu’il cessa cette seconde activité lucrative et dorénavant fort dangereuse ?
J’aime bien la seconde version.
Elle donne à mon grand-père la stature ambiguë d’un héros de film noir où l’espionnage vient se mêler à de sordides règlements de compte. Aucune des deux versions n’est vraisemblablement la bonne, mais cela a-t-il une importance, pour l’instant dans ce récit, il n’y a pas plus de lingots d’or que de beurre en broche.
Si Papy était un héros de film noir, Mamy était-elle une espionne, une Mata Hari résolue à donner son corps et son âme pour sauver la patrie ? Je n’ai aucune confidence recueillie sur un lit d’hôpital permettant d’imaginer une telle version. Dans son délire, proche de la mort, des seringues dans les bras, elle sublimait une dernière fois l’homme qui avait accompagné ses jours et ses nuits et à qui par avance, elle avait tout pardonné.
Quand la famille au grand complet s’est réunie chez le notaire pour la succession, il ne pouvait être question de lingots d’or, de Japon et trafic en tous genres. Furent évoqués une somme rondelette en argent liquide, un contrat d’assurance vie, des actions et obligations, l’appartement de Paris et la maison de Normandie. Aux parents à peu près tout, en parts égales, aux enfants la ferme restaurée de Pont-l’Evêque.
Nous étions tristes. Nos parents avaient perdu leurs bras et leurs jambes et nous nous sentions, nous les petits-enfants, merdeux de n’avoir su il y a deux ans accompagner Papy dans son dernier voyage et Mamy, perdue dans ses délires hallucinogènes.
Fleur, Héloïse, Stéphane, Benoit et moi-même nous sommes retrouvés au studio de Fleur pour évoquer les derniers instants de Mamy et ses révélations étonnantes et tardives. Nous devions nous organiser, faire des comptes, évaluer le cout d’un tel cadeau. Allions nous garder la maison normande, vendre, la transformer en maison d’hôtes, en garden-party permanente où les amis pourraient se réunir sans prévenir ? Chacun donnait son opinion, espérant que d’une cogitation collective la lumière fuse. Ce fut la proposition d’Héloïse qui tint la corde un moment donné : transformer la maison en musée à la gloire de la musique et de notre grand-père, mais bien vite faute d’idée suivante et sur la manière de procéder nous avons laissé tomber.
Et puis Benoit prit la parole. Et si tout cela était vrai ! Le Japon, la traite des partitions, les lingots d’or dans le jardin. Et si, au lieu d’un édifice encombrant, nous étions assis sur un tas d’or ? Et si le chef d’orchestre japonais avait réellement été assassiné par la mafia locale et que Papy avait rapatrié le magot ? Nous étions riches à millions. Qu’avions-nous à perdre à aller nous servir allègrement dans ce qui dorénavant nous revenait de droit ?
Je dois dire que la force de persuasion de Benoit était communicative. S’il en était un parmi nous qui avait, en plus de la maison, hérité du caractère déterminé de Papy, c’était bien lui.
Qu’avions-nous à faire ? Rien de plus simple ! Premièrement sceller un pacte de silence et de confiance, acheter des pelles, des pioches, des sacs à gravats et mettre à sac la maison pour dénicher ce qui nous tendait les bras. Pas un n’évoquât l’éventualité du délire de Mamy et les effets secondaires de la morphine.
Tout cela était fort probable. Nous savions tous, sans nous l’avouer, que notre grand-père était un autre homme que ce qu’il nous laisser entrapercevoir de lui.
Nous avons planifié notre escapade en Normandie. Les vacances de Pâques tombant à point nommé, nous avions une semaine pour que notre chasse au trésor porte ses fruits. Benoit avait récupéré auprès d’un copain une espèce de camionnette bringuebalante dont nous ne savions pas encore si elle allait pouvoir supporter le voyage. L’enthousiasme était tel que naturellement nous avons joué au jeu de qui ferait quoi avec sa part. Fleur ouvrirait son cabinet dentaire, Héloïse achèterait une ile lointaine pour y vivre d’amour et d’eau fraiche avec son copain Léonard, Benoit voyagerait dans le monde entier, rencontrerait des tas de gens et écrirait un livre sur les coutumes des pays traversés et Stéphane ferait de la politique pour changer la planète et éradiquer la faim dans le monde. Je ne savais pas encore que j’en profiterai pour restaurer la maison normande, placer l’argent sur un contrat d’assurance vie rémunérateur et vivre de mes rentes le plus longtemps possible.
Les événements ne se sont pas déroulés comme ils auraient dû. J’en suis le premier responsable. Nous avions choisi l’option de prendre la route nationale afin de ménager le moteur poussif d’une camionnette aussi rassurante qu’une ruine ambulante. Le voyage dura plus de quatre heures durant lesquelles nous faisions et redéfaisions le monde selon notre humeur. J’avais mis à profit ce temps pour retracer les évènements importants d’une vie passée avec mes grands-parents et plus d’une fois, les larmes me montèrent aux yeux. Cela n’était pas possible. Nous étions partis munis de pelles et de pioches mettre sens dessus dessous nos souvenirs d’enfance et le projet d’une vie d’un Papy qui avait sué sang et eau pour maintenir à flots la maison de sa jeunesse. Nous n’avions pas le droit de tout saccager. C’était ma conviction.
Mes cousins chantaient et je me désolais jusqu’à destination.
Arrivés à bon port, nous fûmes tous étreints par la même émotion. Plus un n’avait l’humeur badine, l’envie de casser un mur et démonter un parquet, nous ne savions que faire. Depuis combien de temps n’avions nous plus mis les pieds dans cet endroit ? Le compte fait, le résultat nous désola. Nous nous sommes rendus au salon où trônait en son centre, le piano de Papy. Je me suis installé sur le petit banc de bois prévu à cet effet et j’entrepris de jouer quelques notes en hommage à mon grand-père. Je joue mal, mais je m’étais surpassé en cette circonstance. Les notes sortaient plus fausses les unes que les autres et à la fin de la prétendue Lettre à Elise, j’ai arrêté le massacre. Héloïse vint gentiment à mon secours, affirmant que la première chose à faire serait de réaccorder ce foutu piano. Une larme ne put s’empêcher de couler.
Nous avons passé la nuit à la belle étoile autour d’un feu de camp improvisé et mangé des boites de sardines. Grace à Papy, les petits enfants étaient réunis, mais était-ce pour de bonnes raisons ?
Je ne fermais pas l’œil de la nuit et au petit matin ma décision était prise. Je proposais une réunion improvisée autour d’un café revigorant et fis part de mon intention d’en rester là avec l’héritage de Papy. Je ne voulais rien et surtout pas mettre à bas une maison construite une pierre après l’autre par les différentes générations dont nous étions les héritiers. Agir de la sorte eut été une injure faite à nos ainés.
J’avais une simple demande à formuler avant de quitter les lieux, emporter le piano de Papy. Pour le reste, les lingots, les bijoux, les dollars et les yens, je ne voulais rien. Je ne savais pas si Mamy avait fantasmé un mari aventurier, alors autant faire la part belle à cette histoire et continuer de rêver.
Mes cousines regrettèrent de ne pas avoir eu cet état d’esprit chevaleresque, mes cousins trouvèrent que je manquais de pragmatisme et que je me laissais déborder par les sentiments. J’oubliais un peu vite les absences de notre grand-père, le peu d’affection qu’il nous prodiguait et les remarques pas toujours charitables dont il nous gratifiait. Tout se paye un jour ou l’autre et un trésor était une bonne occasion de pardonner.
Aucun ne tentât de me faire revenir sur ma décision. Aucun ne refusa ma demande.
Je pris la camionnette et me rendis à Pont-l’Evêque en quête d’une entreprise de déménagement de piano et je trouvai assez facilement mon bonheur. Une dame ronde et joufflue me reçut avec un air jovial et commerçant et releva les informations dont elle avait nécessité pour faire un devis. Prenant connaissance du montant indiqué je perdis un instant le souffle. Impossible de faire face avec mes pauvres subsides et je n’avais aucune envie de solliciter l’aide de mes parents. Nous étions quatre à devoir solutionner le problème : Papy en haut dans les nuages, le piano, cette dame et moi. Elle nota mon désappointement et proposa une solution. Un camion partait à vide dans l’après-midi pour Paris, alors pourquoi ne pas y mettre un piano et faire un crochet par mon appartement pour un prix modique, mais pas trop petit quand même. La proposition était raisonnable et j’ai accepté avec une condition additionnelle : attendre l’ouverture de La Poste et débloquer mon livret d’épargne où je disposais de la somme nécessaire. La dame me fit la bise, nous venions de conclure un accord.
Une heure plus tard quatre armoires normandes et humaines à l’aide de sangles et leviers firent irruption dans la maison et embarquèrent en aussi peu de temps que nécessaire un piano lourd de souvenirs et du temps qui passe. Fleur et Héloïse avaient songé m’accompagner pour ce voyage de retour impromptu, mais la curiosité plutôt que la cupidité emporta leur décision. Elles voulaient en avoir le cœur net et retracer le parcours audacieux de notre Papy pour délimiter la frontière qui sépare le mythe de la réalité. Elles sentaient monter en elles la vocation d’une archéologie improvisée et familiale.
Je partis serein, confiant d’avoir fait un choix qui, quelle que soit la suite des opérations, ne mettrait jamais en cause un ordre moral et riche ou pauvre ne ferait l’objet d’aucun regret.
J’avais décrit la configuration de mon appartement et la dame rougeaude et normande, après s’être assurée de la taille réglementaire des fenêtres du salon, avait donné les consignes pour introduire le piano par l’extérieur. J’habite un petit deux pièces dans Paris et la pièce destinée à accueillir mon héritage était à peine plus grande que l’objet qu’elle devait contenir. Les déménageurs, comme s’il s’agissait d’un simple fétu de paille, sans l’évidence de l’effort, en un peu moins de temps que celui dont j’avais besoin pour débarrasser une pièce déjà encombrée, hissèrent le piano jusqu’à sa place définie dans la précipitation. J’allais avoir pour tout meuble un piano impossible à bouger et ne devais pas commettre la moindre erreur d’appréciation. Mon autre minuscule pièce, en plus de chambre à coucher, se transformait en salon où l’on cause, salle à manger et toute autre fonction selon la nécessité en différentes matières. Mon appartement allait devenir invivable surtout que ma médiocrité n’étant pas seule en cause, je devais absolument faire réaccorder un instrument décidément indigne d’avoir accompagné le talent de mon grand-père.
Mes cousins et cousines restèrent une semaine en Normandie. Personne ne prit de mes nouvelles durant trois jours puis Héloïse se souvint de mon existence.
Ils avaient renoncé à faire de la maison un tas de ruines, après avoir quand même percé plusieurs trous béants dans les murs susceptibles de renfermer un quelconque magot. Ils n’étaient plus convaincus de l’utilité de faire tomber ce qui tenait encore debout, l’enjeu et les remords à venir n’en valaient pas la chandelle. C’est le jardin qui fut retourné dans tous les sens et la terre en avait bien besoin. Pendant trois jours et autant de nuits, sans presque dormir, mus par l’excitation de la découverte, deux garçons et deux filles creusèrent mille cinq cent mètres carrés de chaque parcelle d’un jardin dans lequel un cinéaste en mal de reconstitution historique aurait pu tourner un épisode des tranchées de la bataille de Verdun.
Leur pugnacité fut récompensée, Stéphane avait fait une découverte hallucinante, trois sacs en plastique. Dans le premier, trente mille euros en liquide, dans le deuxième un coffret à bijoux en attente d’expertise et surtout dans le troisième, des billets de banques provenant de différents pays, essentiellement des yens japonais. Mamy ne délirait peut-être pas tout à fait.
Ils redoublèrent d’activité, cassèrent un autre mur, arrachant des lattes de parquet ci ou là et ne rentrèrent qu’une fois persuadés n’avoir plus rien à dénicher d’autre en ces lieux. Leur aventure rapporta à chacun l’équivalent de cinquante mille euros et le sentiment d’avoir vécu une aventure un peu hors du commun.
J’étais sincèrement content pour eux, mais déçu par leur attitude égoïste et puérile. Ils me laissèrent au rebut, sans nouvelles des semaines durant, craintifs que j’ose réclamer une part si minime fut-elle. Nous avions un accord sur lequel il n’y avait pas à revenir.
Pour faire plaisir à maman, j’avais décidé de me remettre sérieusement au piano. Je souhaitais interpréter ses morceaux préférés, ceux pour lesquels Mamy avec tant de patience, corrigeait sans jamais marquer le moindre moment d’humeur, mes fautes de débutant.
Les débuts furent difficiles. Ce piano totalement désaccordé devait retrouver une seconde jeunesse musicale et enfin je me décidai. Je fis appel à un spécialiste qui après avoir demandé moult précisions sur la marque, l’ancienneté et la provenance prit rendez-vous pour le début de la semaine suivante. Pendant six jours, je me remis au solfège sans jouer la moindre note.
Je m’attendais à voir entrer un vieux monsieur du genre professeur nimbus aux cheveux blancs et lunettes écaillées et c’est un jeune type d’à peine vingt-cinq ans qui sonna à la porte le jour prévu. Devant le Steinway de Papy il s’extasia. Il en avait rarement vu de la sorte et posa des tas de questions pour lesquelles je n’avais pas toujours de réponse. Heureux de son intérêt je lui parlais de Papy et il fut désolé que son évocation ne déclenche pas en lui le moindre souvenir.
Cela n’était pas si grave, les générations sont faites pour se succéder et la notoriété est comme le papillon qui nait le jour et meurt la nuit, éphémère et ingrate.
Je lui proposai un café avant qu’il se mette à l’ouvrage et il accepta avec enthousiasme. Une fois dans la cuisine, je l’entendis ouvrir le dessus du piano afin qu’il en atteigne le cœur et les cordes mal en point et j’entendis les mots suivants dont je me rappelle encore chacun d’entre eux : « putain, mais c’est quoi ça, c’est un débarras ou un piano ? Vous pouvez-venir ? Je ne sais pas à quoi y jouait votre grand-père, mais pour un chef d’orchestre c’est un peu curieux d’entreposer dans un instrument des petits paquets emballés dans du chiffon. Comment voulez-vous sortir une note convenable avec ça ?
Ça ne m’étonne pas que vous ayez l’impression de jouer comme une casserole. Un piano ça se respecte. C’est quoi à votre avis » ?
Je pris le premier paquet à portée de main et je fus surpris par son poids et sa consistance. Au fond de moi, j’avais déjà compris. J’allai chercher sans hâte une paire de ciseaux, prenant le temps de savourer ce moment et après avoir précautionneusement découpé l’emballage en chiffon, je mis l’objet à nu.
C’est l’accordeur qui prononça les mots magiques : « putain, on dirait un lingot d’or ».
Il y en avait trente.