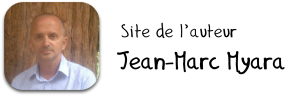Paul n’en revenait toujours pas d’avoir été viré. Après vingt-cinq ans de loyaux services, Georges venait d’avoir sa peau, sans coup férir, à la déloyale. A la mort du fondateur de l’agence, ils étaient tous deux pressentis pour lui succéder, mais Paul se révélait trop tendre pour accéder aux responsabilités. Il est créatif, un réservoir à idées, pas un meneur d’hommes. Ses slogans publicitaires avaient fait la notoriété de l’entreprise et sa fortune, mais il n’en était pas devenu un chef pour autant. Les décisions stratégiques, celles qui engagent et donnent le cap, tout cela était du ressort de Georges.
Paul avait une faiblesse majeure, il ne cernait pas les gens, quand Georges flairait le bon cheval à peine sorti de l’écurie. Les deux hommes s’étaient retrouvés sur la ligne de départ, à égalité, le temps devait les départager. Chacun son domaine. Le résultat au bout du chemin pour seul juge. Georges avait, haut la main, remporté l’épreuve.
Paul était prêt à reconnaitre sa défaite. Il n’est pas honteux d’admettre son seuil d’incompétence et rester dans son pré carré, mais il devenait fâcheux, importun, de trop.
Il avait lui-même recruté Georges il y a bien longtemps et la détermination de ce si jeune garçon à l’époque était saisissante. Il ne se doutait pas qu’il introduisait le ver dans la pomme, creusant sa tombe.
Le « vieux » venait de mourir. Le monde devait continuer de tourner et l’agence de progresser. Les héritiers n’avaient ni l’envie, ni les compétences pour prendre les rênes de l’entreprise. Georges et Paul étaient légataires désignés, ils connaissaient l’importance de leur mission.
Georges pour diriger, Paul pour insuffler l’innovation.
L’agence devait s’ouvrir aux nouveaux médias, aux technologies avant-gardistes et créer une filiale dédiée. Paul s’empara du projet. Georges lui en avait vendu les incroyables perspectives et l’obligation de respecter les dernières volontés du « vieux ». Il ne pouvait se dérober.
Il avait perdu d’avance.
Patron d’une structure nouvelle, il devait assimiler les codes pour commander. Il se rendit bien vite à l’évidence que l’on n’apprend pas à exiger. Il allait tenter de revêtir les habits du leader, de copier Georges pour son autorité brute, innée, mais on ne devient pas Napoléon quand on n’a pas su être Bonaparte.
Il a tenu deux ans, ce n’était déjà pas si mal.
En proposant un projet trop ambitieux, dépouillant son savoir-faire pour lui faire endosser un accoutrement malcommode, Georges jouait sur du velours. Paul ne résisterait pas longtemps et la pomme allait tomber de l’arbre avant qu’elle murisse. Question de patience.
A la mort du « vieux », Georges ne voulait pas laisser de témoins. Tous ceux qui avaient eu affaire à lui, à l’époque où il était malhabile dans ses décisions, tendre dans ses jugements, devaient disparaitre de la surface de la terre. Les plus anciens étaient à la retraite, dans leurs terres, partis profiter du système qui les avait enrichis. Les autres furent licenciés. Aucun ne pouvait plus prétendre l’avoir rencontré en culottes courtes. Paul était le dernier des mohicans.
Il devait quitter l’agence.
Georges, expert en communication, ne se fit pas prier pour répandre la nouvelle de l’incurie de Paul et son échec dans ses nouvelles fonctions. Pris au piège, devenant l’enfant adultérin du « vieux » qui n’était plus là pour le protéger, Paul ne savait plus vers qui se tourner.
Il reconnut sa débâcle et se sentit trop fatigué pour remonter la pente.
Il venait d’avoir cinquante ans. Trop âgé pour repartir de zéro, trop jeune pour se fermer à de nouveaux projets.
Il fit les comptes, négocia avec Georges qui ne mégotta sur rien. Prime de départ, stocks options, avantages divers, il avait de quoi voir venir.
Paul savait tout faire : écrire, sculpter, peindre, il était pourvu de tous les dons, mais avait laissé cet aspect de sa personnalité de côté pour gagner sa vie. Il souhaitait rattraper le temps perdu.
Il était temps de changer d’horizon. Sa dernière femme, Bérangère, corse d’origine, rêvait de retourner au « pays ». La situation de Paul rendait maintenant possible le projet. Ils vendirent l’appartement de Boulogne, les meubles d’époque, quelques inutiles breloques et se mirent en quête d’un nouveau port d’attache.
Les agences immobilières redoublaient de propositions alléchantes, les meilleurs endroits, les places ombragées, les rues commerçantes, les autres, plus secrètes recelant les trésors cachés. Aucun endroit ne trouvait grâce à leurs yeux pour poser les valises.
Bérangère suggéra Calvi. Ce petit joyau de la Balagne avec ses maisons d’ocre et de blanc agit sur le cœur de Paul comme la foudre. Il n’aurait su dire pourquoi, mais l’endroit lui paraissait familier. Les rues, les cafés, les monuments, les marchés et les boutiques, lui rappelait des souvenirs qu’il ne pouvait avoir vécu. Il était coutumier du lieu et pourtant tout était si nouveau. Une étrange mélancolie s’empara de lui et des larmes coulèrent sans qu’il s’en défende. Bérangère fut troublée.
Il dit juste : « c’est là, trouvons notre maison ».
Ils se promenèrent sur le bord de mer. La fin du mois de mai était agréable. A la pluie fine du matin succédait un soleil chatoyant et Paul et Bérangère, main dans la main, déambulaient comme deux adolescents amoureux. Ils étaient apaisés. Ils avaient trouvé leur destination.
Longeant le bord de mer, Paul s’arrêta le long du parapet. Il éprouvait une sensation singulière, inaccoutumée, presque suffocante. Il pointa un petit immeuble du doigt et s’entendit prononcer un simple mot : « ici ».
Certaines maisons du bord de mer possèdent une passerelle qui mène directement sur la promenade. La mer, en contrebas, est si proche, que les habitants, de leur fenêtre, s’imaginent voguant sur un bateau, au gré des flots. L’immensité, imperturbable et céleste, n’est que sérénité. Jamais, depuis tant d’années, Paul ne s’était senti aussi bien.
Bérangère se sentait ébranlée, elle pensait la tâche impossible. Les maisons du bord de mer se transmettent de génération en génération, il est impensable de rompre le cycle. Paul ne devait pas vivre d’illusions.
Ils s’assirent à une terrasse de café où, avec patience et tendresse, elle expliqua qu’à l’impossible, nul n’est tenu. L’endroit qu’il venait de désigner était utopie, mais que peut-être, à une rue de là, simplement derrière, en deuxième rideau, le refuge dont il rêvait lui tendait les bras. Il ne répondit rien, hochant la tête de droite et de gauche pour marquer son accord où sa désapprobation. Il refusait de baisser les bras par avance et voulait tenter le tout pour le tout, déterminé comme jamais. Calvi et pas ailleurs, cet appartement et pas un autre. Encore une fois, il n’aurait su expliquer pourquoi.
Il lui était revenu une anecdote rapportée par une amie chère, Hélène, dont il n’avait aucune raison de douter. Elle venait de divorcer, une séparation douloureuse qui la laissait exsangue. Son mari avait emporté ses illusions, gardé l’appartement et les petites cuillères. Son avocat avait laissé trainé la procédure en longueur pour se faire payer ses mauvais conseils un temps perpétuel. Le mari, pendant cette période, avait peaufiné un dossier à charge, recruté autant de témoins d’immoralité qu’il le fallait pour enfoncer celle qui lui avait donné vingt ans de sa vie et deux enfants. Son père, dans le même temps, venait de mourir d’une longue maladie. Hélène additionnait les malheurs et trouvait que le compte était bon.
Elle était démunie, sans ressources morales et financières. Le monde entier lui tournait le dos. C’était là ce qu’elle ressentait. Elle suppliât son père, où qu’il soit, haut dans le ciel, de lui venir en aide. Elle ne fut pas entendue.
Quelques jours plus tard, la chance semblait enfin tourner. Elle retrouva, au détour d’un chemin, un ami de jeunesse dont elle avait gaspillé le doux souvenir. Elle lui confia son désarroi. Il fut heureux de revoir celle qui avait chamboulé l’esprit de sa jeunesse et souhaita lui venir en aide. Il venait d’hériter d’un appartement au « cent cinquante rue des vignes » dans une banlieue proche de Paris. Il le mettait à disposition, gracieusement, le temps dont elle avait besoin pour respirer librement.
Elle accepta, remercia son ami pour sa générosité et le destin qui avait permis que leurs routes se croisent à nouveau. Elle l’épousera plus tard, mais là n’est pas l’objet du récit.
Elle dut s’occuper de la succession et des dernières affaires de son père, notaire. Des armoires pleines de dossiers à trier. Un devoir irréalisable, elle n’en avait pas la force. Elle ouvrit une première armoire si haute qu’elle dû prendre un tabouret pour se hisser à niveau des dossiers suspendus. Elle tira avec difficulté le premier dossier situé à gauche sur l’étagère du dessus, descendit du tabouret, le posa avec peine puis l’ouvrit. Elle poussa un cri, éclata en sanglot, et tressaillie de tous ses membres. Il y avait inscrit sur la languette : « succession du cent cinquante rue des vignes ».
Elle était persuadée que son père avait entendu sa supplique pour lui offrir une seconde vie et renaître avec celui qui sera un second mari fidèle et aimant. Il n’y avait pas de hasard.
Paul, tirant les enseignements de l’aventure d’Hélène, était persuadé qu’une puissance indéfinissable le poussait vers cet endroit devenu son unique obsession.
Il se renseigna. Qui donc pouvait bien habiter ici et comment faire pour rencontrer celle qui vivait dans cet olympe ? C’était une femme, il en était persuadé. Certainement fragile et douce, il construisait l’image de l’être qui exaucerait ses rêves. Elle était âgée, forcément, certes pas centenaire, avec tellement d’histoires à raconter sur les lieux. Il fallait qu’il en ait le cœur net.
Il chercha tous les prétextes pour se retrouver devant l’immeuble, guettant celle qui en jaillirait. Il fut de prime abord déçu. Le mois de juin touchait à sa fin et les rayons d’un soleil généreux dénudaient les peaux. La plage était joyeuse de nombreux cris d’enfants et les premières baignades de l’été annonçaient un été chaleureux. Aucune personne dont il avait imaginé les contours ne correspondait à ses spéculations. Des pas très vieux, entre deux âges, des plutôt jeunes, entraient et sortaient de l’immeuble. La bâtisse faisait cinq étages, il n’avait que faire des quatre premiers. Il s’imaginait, au plus haut, derrière la fenêtre, contemplant l’immensité de la baie s’offrant en spectacle.
Il revint dix jours de suite, à différentes heures, seul ou avec Bérangère, levant les yeux au ciel, se cognant à tous les réverbères que la promenade avait placé sur son chemin. Il prit une décision et son courage à deux mains. Mu par une soudaine bravoure, sans songer faire marche arrière, il profita d’une ouverture de porte et se glissa à l’intérieur du bâtiment. Il monta quatre à quatre l’escalier et devant l’unique porte palière du dernier étage, le souffle à peine revenu à une cadence normale, il tambourina de toutes ses forces. Il n’eut aucun écho en retour. Il lui semblait pourtant percevoir un léger bruit de fond, une radio avec des éclats de rire, certainement les « grosses têtes » de Philippe Bouvard à cette heure de l’après-midi. Il recommença à signaler sa présence. La radio venait de faire silence et il distingua pendant des secondes longues comme des siècles, des petits pas venant à sa rencontre. Derrière la porte, une voix délicate demanda qui était là et ce qu’on lui voulait. Paul répondit qu’il souhaitait simplement s’entretenir d’une affaire de la plus haute importance.
Etait-ce une voix implorante, la simple curiosité, le besoin de rompre la monotonie qui fit d’une porte close qu’elle s’ouvrit? Peu importe, il était face à celle qu’il reconnut au premier coup d’œil. Paul n’était pas très grand et plutôt chétif, elle aurait pu être de son ascendance. Elle avait l’âge requis, l’apparence du roseau et la force de caractère de ceux qui n’ont pas besoin de crier pour faire entendre leur point de vue.
Les premiers mots étant toujours les plus importants, il se présenta sans calcul, se racontant avec sincérité. Il expliqua la sensation de reconnaître sans confondre, le besoin irrépressible de s’accaparer les lieux, de se sentir chez lui en terre inexplorée, sa gêne d’importuner une vieille dame et le risque de passer pour un illuminé.
Elle fut troublée. Il avait l’âge de son fils unique, un ingrat qui ne donnait aucune nouvelle et semblait se désintéresser d’une mère livrée à elle-même. Il n’aurait pas l’appartement en héritage, elle préférait claquer son argent en alcool et en beaux garçons. Ayant dit cela, elle se mit à pouffer en hoquetant, sûre de sa bonne blague. Paul était tout sourire. Cette femme était renversante d’énergie et de joie de vivre.
Après avoir repris trois fois du thé, englouti un paquet entier de gâteaux secs, rit et plaisanté, elle enregistra sa requête et demanda qu’il fit une proposition : honnête ajoute-t-elle avec un sourire grand comme la baie de Calvi. Il avança un prix.
En négociatrice avisée elle le regarda fixement, sans mot dire, une légère brume dans les yeux signifiant qu’il fallait faire un effort supplémentaire.
Ils se mirent d’accord en moins de temps que n’en prennent les difficiles négociations. Il apprit plus tard que la vieille dame, propriétaire de deux maisons dans l’arrière-pays, ne supportait plus de gravir cinq étages à pieds en fonction des nécessités. Elle vivait en prison, l’escalade se révélant de plus en plus insurmontable. Elle envisageait de quitter les lieux afin de passer une retraite paisible loin du tumulte de la ville. Jamais elle n’aurait imaginé vendre son bien ce prix-là. Peu importe qui fut le plus satisfait, chacun ayant l’impression de faire une bonne affaire.
Cinq mois de formalités administratives furent nécessaires. Le quinze décembre deux-mille-cinq, à onze heures trente du matin, monsieur Domingo et son équipe investissaient les lieux afin de procéder aux travaux selon les plans imaginés par Paul et Bérangère.
La disposition des chambres, de la cuisine et du salon, ne correspondaient pas aux souvenirs de toutes pièces que Paul s’était créé. Il devait retrouver l’appartement tel que son imaginaire lui commandait.
Deux mois plus tard, ils entraient enfin chez eux, définitivement.
Paul était débordant de sources créatives. Comme les êtres doués en tout, il était contrarié par ses dispositions. Il n’était pas un peintre qui ne voulait que peindre, un écrivain cherchant uniquement l’alliance des mots, un sculpteur produisant des formes. Etant tout cela à la fois, il dispersait ses éloquences. En un an, il avait déjà écrit deux romans, modelé dix bustes et accouché d’autant de toiles, composant une œuvre saisissante. Le regard des autres n’étant en rien essentiel, il n’avait nul besoin de reconnaissance. L’admiration que lui vouait Bérangère suffisait à sa soif de création.
Il touchait donc les arts sans en explorer un en particulier. Il sentit là une véritable insuffisance. Un ami qui en avait eu l’occasion donna un avis sur sa peinture. Sa perception prendra toute son importance. Paul, selon lui, peignait « en instantané », saisissant le moindre détail d’un paysage en vision « photographique ». Il était « créateur oculaire ». Il ne savait pas s’il révolutionnerait l’art pictural, mais la science photographique, certainement.
Paul faisait fausse route. Les paroles de son ami agirent comme un électrochoc et il courut acheter un appareil photo dernier cri.
Il se lança dans une nouvelle aventure, heureux d’apprendre. Il souhaitait bouleverser le genre, faire d’une photo une mise en scène, une histoire originale. Il se surprit en plein délit de narcissisme, se racontant au fil des clichés, modifiant le décor au gré de ses humeurs. Il était son principal modèle, source d’inspiration. Il en devenait fascinant de tant d’introspection. Lui qui n’aimait pas spécialement son image, semblait rechercher un autre lui-même afin de se sentir quitte avec son reflet. Une photo semblait résumer son état d’esprit. Il est seul, sur une plage déserte, penché en avant à quarante-cinq degré, en impossible équilibre, regardant au sol un autre lui-même figurant son ombre. Il avait intitulé ce moment : le temps contracté. Il était débout, penché et à la fois déjà allongé. Il était, il sera.
Il fera des centaines de photos. Chacune racontant une histoire singulière. Il n’était pas un voleur de l’instant, n’ayant que faire d’un coucher de soleil ou d’un clocher sous la brume.
La photo est une œuvre pensée, une idée forte, une peinture électronique où le décor alentours, grâce aux nouvelles technologies, peut s’envisager autrement.
Il conçu un ouvrage important. Son imagination débordante le poussait vers différents aspects de lui-même qu’il distinguait au fil de ses inspirations. Il se découvrait intarissable. Ce qu’il aimait par-dessus tout était la transmission du savoir entre les générations : le passage.
Il n’aurait pu accomplir sa « mission » nulle part ailleurs. Il était la journée durant, assis devant son écran d’ordinateur à retoucher un ciel, suggérer un personnage inattendu, présenter une scène insolite. Son refuge était source d’inspiration, mais la mer, les maisons du voisinage, les grains de sable : également. Il devait créer comme on étanche la soif, vite et abondamment, pour reprendre le cours d’une vie laissée de côté le temps de nourrir sa famille.
Comme les passionnés, il souffrait de ne pas créer.
Bérangère voulut lui faire une surprise. Elle avait acheté un gâteau d’anniversaire avec une simple bougie en guise d’ornement. Paul n’en saisissait pas la raison. Il ne pouvait être question de naissances respectives, ni d’un événement majeur. Il consignait les bonheurs à venir sur un calendrier qu’il consultait chaque jour. Il savait son peu d’intérêt pour les célébrations à heures fixes et ne voulait, par simple oubli, froisser personne.
Elle l’interrogea. Il ne trouva pas la raison de cette cérémonie. Après quelques instants de flottement, le sentant perdu en conjectures, elle vint à son secours. Il y a un an de cela, jour pour jour, ils prenaient possession des lieux et, comme de jeunes mariés, il l’avait porté dans ses bras afin qu’elle franchisse le seuil de son nouveau refuge. Paul eu une sensation étrange. Un an déjà, cela importait peu. C’est comme s’ils avaient toujours vécu en cet endroit. Le monde d’avant était un lointain souvenir. Il avait si peu compté. Une boucle s’était bouclée et le temps révolu était une vue de l’esprit. Il venait de renaître à cinquante ans.
Il insérait, dans ses photos, des comparses imaginaires qu’il mêlait à de véritables personnages. Si lui-même tenait le rôle central, au sens strict du terme, des créatures chimériques côtoyaient des êtres proches, vivants ou morts. Son cosmos était ensorcelant.
Il craqua une seule fois. Une galerie mettait ses murs à disposition afin que son œuvre soit visible par le plus grand nombre d’initiés, mais il regretta sa décision. Il vendit quelques clichés afin de rembourser l’attentionné mécène pour les frais engagés et ne renouvela pas l’expérience. Il n’était pas sujet à spéculation.
Il se familiarisa avec les réseaux sociaux et rapidement, passa du succès d’estime à une attente effrénée. Les commentaires allant bon train, il se faisait un devoir de répondre à tous.
Il aurait pu se prétendre heureux. Il ne l’était pas complètement. Une question en particulier n’avait toujours pas obtenu sa réponse et le laissait dubitatif. Une simple interrogation résumait son état d’esprit : pourquoi ?
Pourquoi ce sentiment de revenir chez lui dans un lieu inconnu ? Pourquoi ne pouvait-il en être autrement ? Pourquoi ce temps gaspillé à faire autre chose ?
Quelques temps plus tard, il obtint un début de réponse.
Il en fut troublé au plus haut point.
Paul avait toujours entretenu avec sa mère une relation difficile. Il aimait cette femme au-delà de tout, sans pouvoir exprimer ses sentiments. Par cette pudeur, une personne étrangère à leur relation, aurait pu discerner une certaine froideur. Il n’en était rien. La glace en apparence fondait bien vite quand elle prenait sa main dans la sienne. Paul volubile par ailleurs était plutôt taiseux pour exprimer ses sentiments envers celle qui le mit au monde.
Il avait la désagréable impression de ne pas avoir suffisamment dit : « je t’aime », à celle qui aujourd’hui manquait à tout le monde, cruellement.
Lui qui fabriquait des souvenir photographiques, se penchait assez peu sur son passé jusqu’à ce jour où la nostalgie fut plus forte que les regrets. Il retrouva dans un carton à chaussures des tas de photographies d’un autre âge. Sa mère l’avait quitté depuis une dizaine d’année et jamais il n’avait eu la force de renouer avec une période accomplie, quand le noir et le blanc évoquaient la douceur sublimée des temps anciens.
Il les considéra l’une après l’autre, offrant à chacune le temps de raconter une histoire. Sa mère bien sûr, apparaissait souvent, mais aussi sa grand-mère, les oncles et tantes, une famille aujourd’hui complètement disparue.
Et puis, un choc. La tête qui bourdonne, l’esprit qui s’échappe, la conscience qui dicte que cela est improbable, impossible, incommensurable. Il avait remarqué une photo, distraitement, pour ne pas sombrer dans une profonde langueur, mais sa conscience lui intimait d’y revenir.
Une famille, sept personnes, faisait une halte le long d’une promenade en bord de mer. Paul identifia sa grand-mère accompagnée d’un de ses frères et de deux sœurs, un petit garçon et deux petites filles. La mer est derrière eux. Ils sont debout, le dos à la rambarde. Tout le monde parait statique sauf une petite fille qui, les yeux levés, désigne un objet du doigt ou plutôt une direction, un lieu en particulier. Paul n’y avait pas prêté plus attention que cela, mais maintenant il scrutait la photo, le cœur affolé de ne pas continuer de battre à une cadence régulière.
Tout cela paraissait inimaginable. Il reconnut la scène où le cliché fut saisit, elle lui était familière. Il n’y avait aucun doute. Sa famille se trouvait sur la promenade de Calvi, celle-là même qu’il empruntait au quotidien. Il disséqua la photo, grossissant chaque détail comme une loupe qui s’attarde en différents points. Il recoupa les éléments les plus tangibles, les disposa en fonction d’une échelle évaluant les distances, identifia certaines données et quand il fut certain de sa conclusion, il se mit à pleurer, à chaudes larmes, comme un enfant.
Il recommença, pour être sûr. Comme un scientifique se fiant uniquement à l’expérimentation, il reprit l’ensemble de ses investigations. Il ne délirait pas. Quand l’évidence fut établie, il pleura de nouveau.
Il attendit Bérangère, lui montra la photo. D’un œil exercé, elle eut besoin de moins de cinq secondes pour dire quelque chose du genre : « c’est curieux, marrant, qui sont ces gens ? La photo est prise devant chez nous ».
Elle enchaîna : « Qui est cette petite fille qui semble pointer du doigt notre appartement » ?
Paul répondit juste : « c’est maman ».